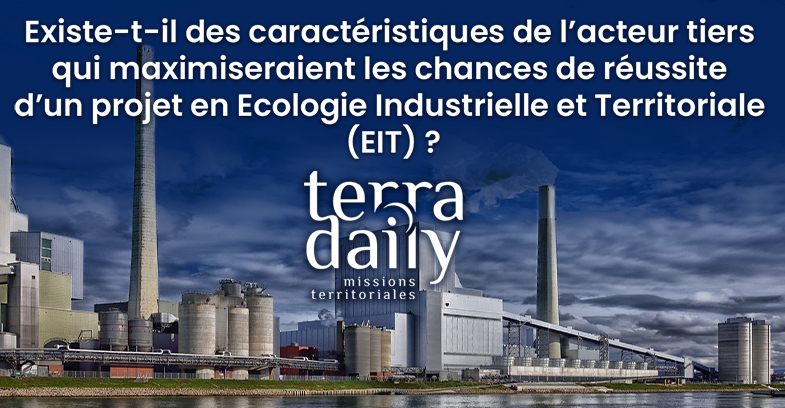Le cabinet Terra Daily a mené une étude d’envergure afin de comprendre en quoi l’acteur tiers facilite les démarches d’écologie industrielle et territoriale.
Vous trouverez en pièce-jointe le résumé de cette étude en français en en anglais
Résumé
Mots clefs : Economie Industrielle et Territoriale, Acteur tiers, Animation, Coordination
Selon l’OCDE (C. Bremer, 2018), l’utilisation de matières premières devrait doubler d’ici 2060 dans le monde. Si nous nous référons aux neuf limites planétaires, une sixième, celle du cycle de l’eau douce, vient d’être dépassée en septembre (Stockholm résilience center, 2023).
Afin de répondre au défi de maîtrise des matières premières, le concept d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) (Frosch & Gallopoulos, 1989) est apparu dans les années 1980.
L’EIT se présente comme un champ scientifique et une démarche opérationnelle de gestion des ressources à l’échelle d’un territoire. Selon Synapse (qui est le réseau national officiel des acteurs de l’EIT), 308 projets d’EIT sont répertoriés en France à ce jour. Pour l’association Orée qui fédère et anime les projets d’EIT en France depuis une trentaine d’années, statistiquement, seule la moitié des démarches sera pérenne.
En effet, de nombreux acteurs gravitent au sein des démarches d’EIT (collectivités, entreprises, associations, animateurs…). La littérature recense quelques facteurs de succès comme une stratégie claire de territoire, une coopération systématique entre les acteurs, une animation efficace et une gouvernance partagée. Prenant appui sur ces facteurs, les démarches d’EIT doivent permettre de générer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques.
Opérant dans un environnement économique de plus en plus incertain et complexe, l’acteur tiers qui désigne la structure interface au sein de l’écosystème d’acteurs, se présente comme un catalyseur, un facilitateur et un accompagnateur des parties prenantes.
A partir de l’analyse des facteurs de succès des démarches d’EIT, le but de cette étude consiste à comprendre les spécificités de l’acteur tiers afin de saisir en quoi il y contribue positivement.
Cette question n’ayant pas fait l’objet d’études spécifiques, l’ambition de cette thèse professionnelle est de pouvoir aider principalement l’association Orée, l’ADEME, le réseau Synapse, à mieux cerner les attributs de l’acteur tiers afin de comprendre son impact dans le succès des projets en EIT et d’en tirer de bonnes pratiques pour tous les territoires.
Notre étude s’appuiera d’une part sur une littérature en plein essor depuis les années 2000.
D’autre part, une étude qualitative via des entretiens semi-directifs impliquant trente-et-une personnes en charge de projets d’EIT, en France et à l’étranger, a été conduite sur trois mois.
Ces interviewés occupent principalement les fonctions d’animateurs, d’élus, de chefs d’entreprises ou chefs de projet CCI et ADEME.
Les premiers résultats de l’étude montrent que nous pouvons mesurer le succès d’une démarche selon cinq domaines distincts. En premier, les démarches doivent bénéficier d’un portage politique avec des élus engagés. Si ce dernier est combiné avec le soutien de l’ADEME, il sera d’autant plus efficace. A contrario, un manque de stratégie de territoire, un défaut de soutien de la part de la région ou du département peuvent s’avérer dommageables. En second, il est important que le territoire dispose d’un tissu industriel riche et diversifié composé de nombreuses entreprises. Les zones portuaires favorisent grandement le développement de démarches. Le fait de disposer de PME plutôt que de grands groupes sur ces zones favorise le degré d’implication territoriale ainsi que les prises de décisions rapides. En troisième, le modèle économique de la démarche doit montrer des résultats probants et tangibles afin d’assurer sa pérennité. Une adhésion pécuniaire à un club ou une association est à privilégier afin d’équilibrer le financement entre public et privé. De surcroît, les motivations des entreprises restant principalement d’ordre économique, il faut que ces démarches puissent générer des « quick win » très rapidement. En quatrième, la gouvernance doit impliquer toutes les parties prenantes au projet, être dynamique et démocratique. De plus, il faut éviter que cette gouvernance ne repose que sur quelques personnes. En dernier, le rôle et l’influence de l’acteur tiers sur les autres acteurs seront déterminants dans le succès des démarches. Il interagit aussi directement au sein de deux des précédents domaines mentionnés ; à savoir le modèle économique et la gouvernance. Il se présentera idéalement sous forme d’une structure hybride.
La création d’une marque favorisera la reconnaissance et la communication de l’acteur tiers sur le territoire.
En conclusion, l’acteur tiers doit disposer d’un nombre suffisant de salariés opérant sur le territoire. Ces personnes doivent disposer de solides connaissances théoriques et d’expériences professionnelles probantes afin de conduire ces démarches d’EIT. De bonnes pratiques existent dans ce domaine dans de nombreux pays, notamment en Belgique. Mais quel est l’avenir même de la politique d’EIT en France ? L’EIT n’est-elle pas concurrencée par d’autres stratégies tels les projets ZIBAC et par de nouvelles formes de symbioses industrielles ? Malgré ces risques, l’EIT devrait encore se développer en France dans les prochaines années. Quelle que soit la stratégie territoriale développée, l’acteur tiers restera le pilote incontournable de la transition écologique des territoires.
Abstract
Keywords: Industrial and Territorial Economy, Third party actor, Animation, Coordination
According to the OECD (C. Bremer, 2018), the use of raw materials is expected to double by 2060 worldwide. If we refer to the nine planetary limits, a sixth, that of the freshwater cycle, was just exceeded in September (Stockholm resilience center, 2023).
To respond to the challenge of mastering raw materials, the concept of Industrial and Territorial Ecology (ITE) (Frosch & Gallopoulos, 1989) appeared in the 1980s.
The ITE presents itself as a scientific field and an operational approach to resource management on a territorial scale. According to Synapse (which is the official national network of ITE players), 308 ITE projects are listed in France to date. For the Orée association, which has brought together and led ITE projects in France for around thirty years, statistically, only half of the approaches will be sustainable.
Indeed, many actors gravitate within ITE approaches (communities, companies, associations, facilitators, etc). The literature identifies some success factors such as a clear territorial strategy, systematic cooperation between stakeholders, effective coordination, and shared governance.
Building on these factors, ITE must generate environmental, social and economic benefits.
Operating in an increasingly uncertain and complex economic environment, the third-party actor, which designates the interface structure within the ecosystem of actors, presents itself as a catalyst, a facilitator, and a support for stakeholders.
Based on the analysis of the success factors of ITE approaches, the aim of this study is to understand the specificities of the third party to discern how it contributes positively.
This question having not been the subject of specific studies, the ambition of this professional thesis is to be able to mainly help the Orée association, ADEME, the Synapse network, to better understand the attributes of the third party to perceive its impact on the success of ITE projects and to derive good practices for all territories. Our study will be based on one hand on a literature that has been booming since the 2000s. On the other hand, a qualitative study via semi-structured interviews involving thirty-one people in charge of ITE projects, in France and abroad, was conducted over three months. These interviewees mainly occupy the positions of facilitators, elected officials, business leaders or CCI and ADEME project managers.
The first results of the study show that we can measure the success of an approach according to five distinct areas. First, the approaches must benefit from political support with committed elected officials. If the latter is combined with the support of ADEME, it will be even more effective. Conversely, a lack of territorial strategy, a lack of support from the region or district can prove damaging. Secondly, it is important that the territory has a rich and diversified industrial fabric made up of numerous companies. Port areas greatly encourage the development of approaches. Having SMEs rather than large groups in these areas promotes the degree of territorial involvement as well as rapid decision-making. Third, the economic model of the approach must show convincing and tangible results to ensure its sustainability. A financial membership to a club or association is preferred to balance funding between public and private. Furthermore, since the motivations of companies remain mainly economic, these approaches must be able to generate “quick wins” very rapidly. Fourth, governance must involve all stakeholders in the project, be dynamic and democratic. In addition, we must prevent this governance from relying only on a few people. Finally, the role and influence of the third party on other actors will be decisive in the success of the process. It also interacts directly within two of the previous areas mentioned, namely an economic model and governance. It will ideally be in the form of a hybrid structure. The creation of a brand will promote the recognition and communication of this actor in the territory.
In conclusion, the third-party actor must have enough employees operating in the territory.
These people must have solid theoretical knowledge and convincing professional experience to conduct these ITE projects. Good practices exist in this area in many countries, particularly in Belgium. But what is the future of ITE policy in France? Is the ITE not in competition with other strategies such as ZIBAC projects and new forms of industrial symbioses? Despite these risks, the ITE should further develop in France in the coming years. Whatever the territorial strategy developed, the third-party actor will remain the essential driver of the ecological transition of territories.